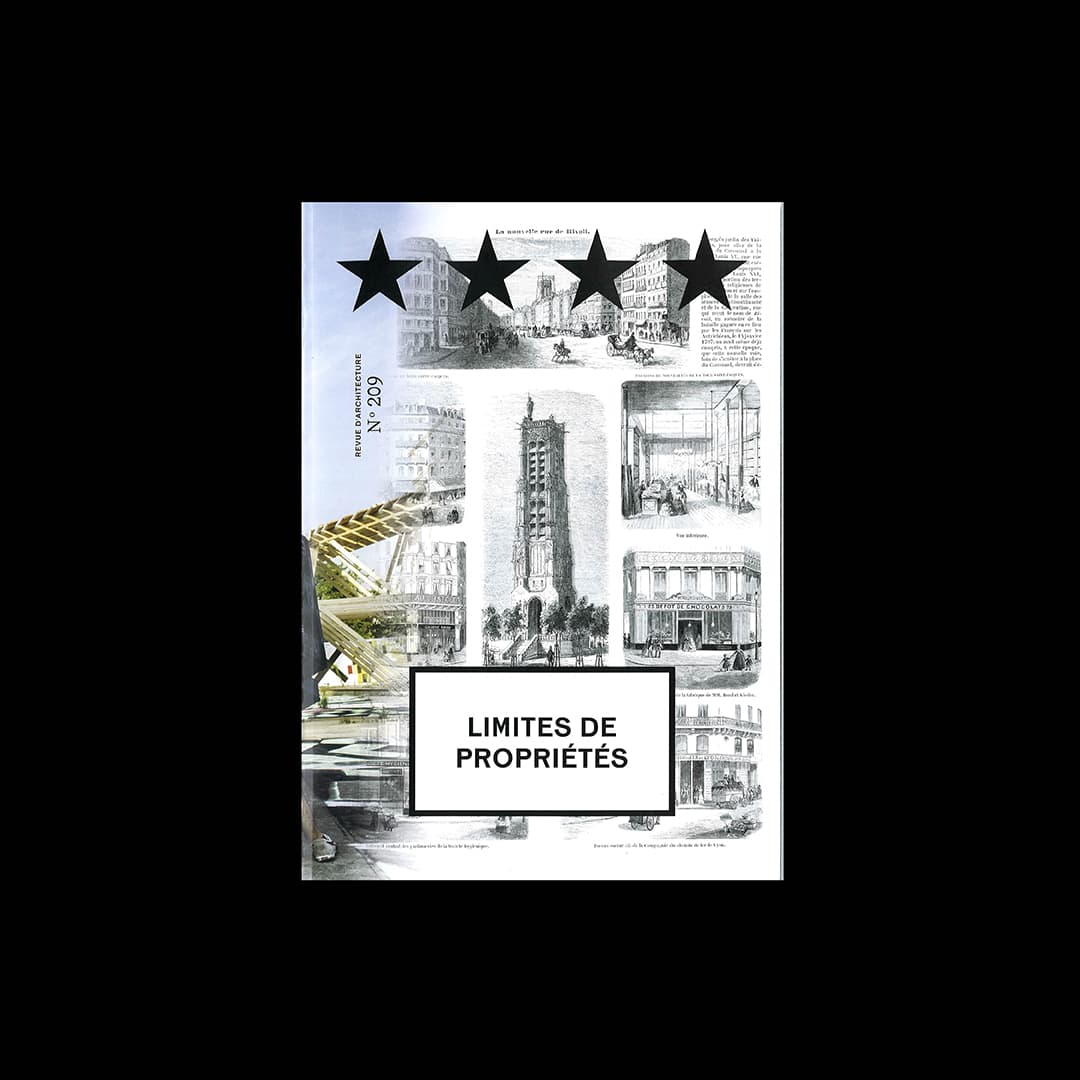Pierre Dardot est philosophe au Laboratoire Sophiapol de l’université de Paris Nanterre. Parmi ses ouvrages : avec Christian Laval : Commun. Essai sur la révolution du XXIe siècle (La Découverte, 2014) et Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’État (La Découverte, 2020) ; avec Haud Guéguen, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux éd., 2021) ; La mémoire du futur Chili 2019- 2022 (Lux éd., 2023). Il est membre du GENA (Groupe d’études sur le Néolibéralisme et les Alternatives) fondé en 2018 (★★★)

Le public et le privé se sont historiquement construits à partir du droit de propriété. D’un côté, la propriété d’État ; de l’autre, la propriété privée. Il y a une certaine symétrie entre ces deux types de propriété qui vient d’une commune logique exclusiviste : la souveraineté étatique implique un monopole sur un territoire et le droit de propriété a souvent été considéré comme une « souveraineté sur la chose ». Le commun remet en cause ce primat de la propriété en privilégiant l’usage. Le droit moderne a tenu l’usage simple (usus) pour une forme inférieure et dégradée du droit de propriété dont la forme la plus haute serait l’abusus. En étant ainsi subordonné à la propriété exclusive, l’usage est tiré vers la consommation et la destruction (l’abusus). À l’inverse, les communs ouvrent la voie à une réélaboration du concept d’usage qui a une grande portée, celui de l’usage collectif comme veille, soin, entretien. Le commun est précisément le principe qui commande de subordonner la propriété à l’usage commun. En ce sens il constitue une rupture avec la conception absolutiste de la propriété qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui. Quant aux communs, ils correspondent aux diverses formes d’auto-organisation que prend ce principe lorsqu’il est mis en œuvre dans des pratiques concrètes : il y a ainsi des communs urbains, des communs forestiers, des communs numériques, etc.
Pourquoi parler de commun au singulier ? Il est courant d’utiliser indifféremment « biens communs » ou « communs ». Cependant, lorsque l’expression de « biens communs » désigne les communs, le terme de « biens » ne renvoie pas à des choses mais à des pratiques sociales et des relations sociales. Les communs n’existent que dans et par de telles pratiques. Un exemple : en France, l’eau est reconnue comme « bien commun » parce qu’elle correspond à un droit élémentaire, mais les gros céréaliers veulent s’en assurer le monopole en pompant l’eau des nappes phréatiques et des rivières pour constituer des réserves artificielles (les « mégabassines »). Reconnue comme bien commun, l’eau n’est pas vraiment un commun. La même remarque vaut sur le plan international. Par exemple, depuis 2022 l’État espagnol a décidé de retenir l’eau du fleuve Douro, qui vient de sources situées en Espagne, en violation de la convention d’Albufera de 1998, par laquelle il s’est engagé à garantir un débit d’eau minimum à son voisin portugais. Autrement dit, s’il peut exister des « communs de fait », au sens où telle réalité de géographie physique est commune à plusieurs pays, cette réalité ne se traduit pas par un commun politique transnational. Un accord de gouvernement ou entre deux ministres chargé·es de son application ne suffit pas à constituer un tel commun. Un commun se constitue par le bas à partir des citoyen·nes comme coparticipant·es d’une activité commune qui fonde une co-obligation (cummunus). Aussi, ce que nous appelons le principe du commun n’est-il pas un principe unitaire ou un principe supérieur, mais un principe transversal qui se dégage d’une expérience riche et multiforme. Il ne précède pas les pratiques sociales et politiques mais il les informe de l’intérieur en reflétant leur diversité : aussi les pratiques de la démocratie (du conseil de gouvernement à l’assemblée) y sont elles-mêmes diverses. L’essentiel est de comprendre que les communs sont des formes d’autogouvernement collectif qui mettent en œuvre le principe du commun comme principe de la démocratie.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES COMMUNS
A/ Le premier trait est la dimension institutionnelle des communs. Qu’entendons-nous par « institution » ? Nous entendons ici faire droit au sens actif du terme : c’est le faire instituant plutôt que l’institué existant qui importe ici. Instituer, c’est faire exister quelque chose de nouveau mais à partir de ce qui existe déjà. Deux formes sont particulièrement importantes : soit créer de nouvelles institutions parce que celles qui existent sont devenues des obstacles (par exemple, créer une coopérative autogérée), soit transformer ou altérer l’institué qui existe déjà parce qu’il vaut la peine de sauver en lui ce qui peut l’être (par exemple, démocratiser un service public). Nous parlons alors de pratiques instituantes qui peuvent être « créatrices » ou « altératrices » et qui consistent à produire collectivement des règles par une délibération commune.
B/ Le deuxième trait des communs est le fait qu’ils soient situés dans un territoire. Il y a des territoires plus ou moins continus qui occupent une surface assez étendue, comme les territoires ancestraux des communautés autochtones en Amérique latine, ou plus restreints, comme les ZAD (Zone À Défendre). Mais cette dimension de territorialité est en même temps une dimension conflictuelle dans la mesure où les collectifs qui défendent ces espaces entrent en conflit avec d’autres acteur·ices, ce qui signifie que les communs s’expérimentent à travers l’exercice d’une territorialité disputée. Encore faut-il s’entendre sur la notion de territoire. Il faut en effet distinguer le territoire administratif et le territoire comme milieu de vie. Le territoire sur lequel l’État moderne exerce sa souveraineté est une surface de projection du pouvoir politique et toute portion de ce territoire peut être exactement mesurée en tant que subdivision administrative. Le territoire comme milieu de vie est fait de multiples rapports entre un ou des collectifs humains et des vivant·es non-humain·es. C’est pourquoi ces territoires peuvent être difficilement enfermés à l’intérieur de frontières administratives.
C/ Troisième trait : en raison d’un tel lien avec les territoires, les communs ne sont pas des choses et les acteur·ices des communs ne sont pas des sujets qui feraient face à des choses. Un 73 commun est un lien vivant entre un ou plusieurs collectifs d’acteur·ices humain·es et un certain milieu (une terre, une rivière, une forêt, un terrain dans un quartier urbain, un édifice occupé dans un quartier, etc.). Ce qui veut dire que ces collectifs font partie du commun lui-même, loin de le piloter de l’extérieur. En ce sens, les communs déjouent l’opposition sujet/objet si caractéristique de la philosophie occidentale, qui présuppose deux pôles préexistants et déjà constitués : d’un côté, le sujet d’une maîtrise, de l’autre, un objet inerte, dépourvu de conscience et offert à la prise souveraine du sujet. Un exemple illustre très bien l’inséparabilité des collectifs humains et des milieux de vie : en 2015 le fleuve Rio Doce a été contaminé par une boue toxique composée de déchets de minerai de fer sur plus de 600 km. Ce fleuve n’est pas une « ressource », mais « une partie de notre collectif », affirme Ailton Krenak, figure des luttes autochtones du Brésil. C’est cette réalité que consacre le Parlement néozélandais en mars 2017 en dotant le fleuve Whanganui d’une personnalité juridique. La Mar Menor, une immense lagune d’eau salée victime de la pollution aux nitrates, a obtenu en 2022 une personnalité juridique destinée à la protéger. Les communs consistent d’emblée en des relations dont les termes ne sont pas donnés antérieurement à elles.
D/ Quatrième trait : les communs inquiètent, par leur seule existence, la dualité du public et du privé qui constitue la division ultime du droit occidental depuis le XVIe siècle. Cette division impose une logique infernale : l’État se donne comme le seul garant de l’intérêt général et s’arroge le monopole du public, de sorte que tout ce qui ne fait pas partie du public est rejeté dans le privé. Le droit reste largement prisonnier de cette division et a du mal à admettre que des acteur·ices collectif·ves autonomes vis-à-vis de l’État puissent se constituer autour d’intérêts communs sans être des acteur·ices privé·es et en étant pleinement légitimes. Le fait est que les communs brouillent le face-à-face entre l’État détenteur de la puissance publique et les acteur·ices privé·es. Ils se comprennent souvent ell·eux-mêmes comme une sorte de public non-étatique ou ils ouvrent l’espace d’un tel public.
LE COMMUN ET LE LOGEMENT
Le droit au logement
En quoi ces réflexions peuvent-elles nous aider à poser la question du logement ? Comme le rappelle Marta Sequeira, le droit au logement est inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains de 1948 et dans la Constitution portugaise de 1976. Mais en fait, à la veille des 50 ans de la révolution du 25 avril, les fortes revendications qui se font entendre dans les rues des principales villes du pays reflètent le fait que le logement a été le secteur le plus marginalisé de l’État social. Les manifestations du 1ᵉʳ avril 2023 ont fait entendre le mot d’ordre : « Des logement durables pour un avenir meilleur ». La situation est telle que de plus en plus de travailleur·ses précaires s’installent dans des tentes loin de la ville plutôt que de dépenser leur maigre salaire pour un logement précaire. De manière générale, dans toute l’Europe, le ciblage des « vulnérables » (enfants, handicapé·es, immigrant·es, personnes âgées, etc.) traduit un recentrement des politiques publiques sur la responsabilisation individuelle davantage que sur les droits et les protections collectives. De ce fait, les financements destinés à l’hébergement dans le volet logement des politiques publiques progressent très sensiblement contri- buant au brouillage entre logement et hébergement.
Une transformation de l’État
Historiquement, le logement ne s’est pas vu reconnaître la nature d’un bien à garantir collectivement, à la différence de la santé et de l’éducation, « piliers traditionnels de l’État providence ». L’affirmation constitutionnelle du droit au logement a le sens d’un « droit créance» visant à provoquer l’action étatique mais, en même temps, cette affirmation n’implique pas toujours l’applicabilité directe de ce droit. Ce droit incombe à l’individu, susceptible de le faire valoir dans sa relation avec les autres individus en tant que membre d’un groupe. En outre, sa réalisation dépend de certaines conditions que seul l’État peut réunir. Dans la plupart des pays, le caractère indirect de l’applicabilité du droit le fragilise : tout dépend des moyens attribués par le·la législateur·ice, car le droit au logement n’est pas un droit par rapport à l’État mais un droit avec l’aide de l’État. Il y a là une transformation profonde de la fonction de l’État, le passage d’un État providence à l’État facilitateur, car ce déplacement de l’assurantiel à l’assistanciel manifeste une pénétration de la logique néolibérale dans la redéfinition des missions de l’État.
Des communs du logement à la ville comme commun
Quelle réponse peut-on apporter ? Il faut tout d’abord prêter attention aux possibilités ouvertes par le type de propriété. La notion générique d’« habitat participatif » regroupe en fait des projets très divers, voire hétérogènes, qui font tous appel à la participation directe des habitant·es à la conception et/ou à la gestion de leur habitat. On peut distinguer plusieurs types en fonction de la forme prise par le projet en termes de propriété des logements.
En premier lieu, la coopérative d’habitant·es qui repose sur la propriété collective : l’idée est ici de séparer l’usufruit (l’usage du logement) attribué à l’habitant·e de la nue-propriété attribuée à la seule coopérative qui donne la possibilité de vendre le bien (comme c’est le cas, par exemple de La Borda à Barcelone depuis 2015). Ces coopératives sont à distinguer des coopératives de construction de logement où seules la construction et la réhabilitation sont réalisées par une société coopérative. Enfin, dans l’habitat coopératif les habitant·es mettent en place une gestion collective et coopérative des logements et des espaces communs tout en étant propriétaires privé·es de leur logement.
Le Community land trust représente une nouvelle forme de socialisation du sol qui n’est ni une étatisation ni une municipalisation, mais une socialisation par un organisme privé à but non lucratif qui consacre la dissociation entre propriété foncière (le sol) et propriété immobilière (le bâti). Un exemple en est la proposition Commons Josaphat à Bruxelles qui ambitionne de construire un quartier sur une friche de 24 ha et regarde la production de la ville comme relevant non d’une décision de l’exécutif politique d’une expertise technique, mais d’un choix collectif des habitant·es. Au-delà de cette hétéro- généité, ce qui frappe dans les communs urbains, c’est la priorité reconnue à l’usage du logement par les habitant·es (l’emphytéose est destinée à garantir la continuité de cet usage dans le temps, comme l’exemple de Barcelone le montre).
Dans le catalogue de l’exposition Habitar Lisboa1, Marta Sequeira souligne à bon droit à quel point la question immédiate et urgente pour la ville de Lisbonne est celle du renforcement du parc de logement social et la création de logements abordables. Mais, au-delà de cette réponse immédiate, elle énonce cette conviction :
« nous n’avons pas seulement besoin de logements, nous en avons besoin pour avoir de l’architecture. » Ce n’est pas seulement la construction de 26 000 logements planifiés pour 2026, mais c’est la ville et la qualité de vie générée par ces logements qui est visée. Elle mentionne plusieurs contributions dont l’une souligne le besoin de territorialiser la politique de logement public ou l’autre pro- pose la définition de « huit villes » en fonction de groupes d’unités territoriales caractérisées par une identité interne. On retrouve ici le territoire comme milieu de vie. En définitive, ce ne sont pas seulement la place des communs de logement dans la ville, c’est la co-production de la ville comme commun qui est en cause.
Architecture et commun
Que peut-on en conclure concernant le rôle de l’architecte ? L’étymologie du mot grec : arkhitektôn, composé de arkhos et de tektôn, renvoie au·à la maître·sse d’œuvre ou à l’ingénieur·e en construction navale, par opposition au·à la manœuvre ou à l’ouvrier·e. Cette définition a inspiré des analogies entre architecture et politique. Ainsi chez Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque, l’architecture est l’art par excellence en tant qu’elle a pour fin de produire une œuvre. Dans cette optique, la politique admet deux espèces, l’une qui est législative et qui renvoie à la délibération collective de l’assemblée du peuple (ecclêsia) ; l’autre qui est exécutive et qui renvoie à l’application des lois par les gouvernant·es. Les législateur·ices sont semblables aux maître·sses d’œuvre et aux architectes, les gouvernant·es appliquent les lois faites par les législateur·ices, semblables en cela aux artisan·es et aux manœuvres commandé·es par l’architecte. Dans le catalogue mentionné plus haut deux aspects de l’architecture ressortent : d’un côté, des projets rassemblant des professionnel·les venu·es d’aires différentes : sociologie, économie, politique, géographie, paysage et architecture ; d’un autre côté, un rapport privilégié aux habitant·es regardé·es avec les architectes comme « les instigateur·ices vitaux·les d’un changement de paradigme». Envisagée dans cette perspective, l’architecture peut contribuer par son expertise propre à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de la ville qui soit l’affaire des citoyen·nes. Mais s’il y a des expert·es techniques qui doivent aider les citoyen·nes à délibérer et à décider collectivement, il n’y a pas d’expert·es en politique (Castoriadis). Ce qui est en jeu, c’est l’idée que l’on se fait du «vivre ensemble » : « vivre ensemble (su-zên) implique un œuvrer ensemble (sunergein) » (selon Aristote), verbe qui a donné le mot très à la mode de « synergie ». L’architecte en tant qu’expert·e technique est un·e « co-œuvrant·e », c’est-à-dire quelqu’un qui œuvre avec les citoyen·nes à la production de la ville comme commun.
Ce texte est issu de la table ronde A CONSTRUÇÃO do COMUM qui a eu lieu le 17 mars 2024 au Centre d’architecture CCB / Garagem Sul à Lisbonne, dans le cadre de l’exposition Habitar Lisboa (commissariat : Marta Sequeira) et du festival Uma Revolução Assim – a Questão da Habitação (commissariat : Julia Albani), en partenariat avec le Goethe Institut et l’Institut Français.
- Sequeira, Marta. 2023. Centro Cultural de Belém, et IS- CTE. Ed. Living in Lisbon: An Architectural View on Housing Challenges. Lisbonne : Monade. ↩︎