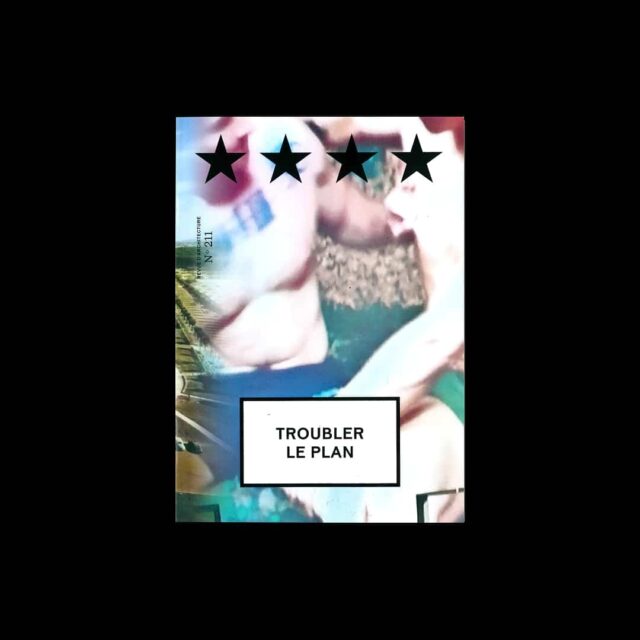
Troubler le plan
Le plan moderne s’est voulu neutre, rationnel, reproductible. Avec le typical plan1, Rem Koolhaas a exposé la logique impérieuse de la standardisation qui organise l’espace tertiaire selon des modules sans qualités, des séquences sans histoires, des grilles où le sujet s’efface. Ce plan, produit de la modernité capitaliste, prétendait l’universalité : à chaque fonction, son espace ; à chaque corps, sa case. Mais ce plan, typique, est aussi un plan normatif. En effaçant les singularités, il impose des modèles d’usage, de comportement, de relation. Étendons ce constat à la manière dont le logement collectif se produit avec ses granulométries, ses types – T1-T1bis-T2-T3-T4-T5 – qui répondent plus aux attentes des familles nucléaires qu’à la diversité des formes de vie actuelles.
Judith Butler, dans Gender Trouble2, a déconstruit une autre prétention à la neutralité – non plus dans les dispositifs spatiaux, mais dans les constructions identitaires. Elle démontre que le genre ne relève pas d’une essence mais d’un acte répété, codifié, performé. Ce que nous croyons stable est en réalité une production continue de normes. L’espace architectural, à son tour, peut être lu comme un dispositif performatif : il produit, à travers ses murs, ses seuils, ses distributions, des comportements attendus, des assignations de rôle, des hiérarchies implicites. Il peut assigner ou émanciper, contenir ou exposer, permettre ou interdire.
Dans cette lignée, Donna Haraway nous invite à « rester avec le trouble » (Staying with the Trouble)3. Le trouble n’est pas un désordre à corriger mais une condition fertile : un mode d’existence situé dans l’incertitude, la contamination, la transformation. Troubler le plan, c’est justement refuser la fixité – celle des normes d’habiter, de circuler, de se montrer. C’est embrasser la friction, les écarts, les arrangements instables. C’est désapprendre les oppositions binaires entre public et privé, entre licite et illicite, entre visible et invisible. En architecture aussi, le plan est performatif. Il peut, par ses murs et ses seuils, assigner ou émanciper, contenir ou exposer.
Tout au long du numéro, les récits relatés expriment une manière d’habiter issue de configurations que l’architecture ignore souvent : familles choisies, alliances affectives non reproductives, collectifs de survie. Le plan moderne, pensé pour la cellule familiale nucléaire ou pour l’individu·e standardisé·e, échoue à les accueillir. Il faut dès lors inventer des spatialités post-familiales, capables de répondre à des relations qui ne se laissent pas cartographier en mètres carrés par occupant·e. Ce n’est plus la typologie qui fait le foyer, mais les alliances affectives, les communautés de soin, les gestes de résistance quotidienne.
Ce numéro de Plan L**** explore ces marges où le plan cesse d’être typique pour devenir ambigu, instable, transformable. Là où l’espace, comme le genre, se performe, se négocie, se brouille. Là où l’architecture ne sert plus seulement à ordonner le monde, mais à révéler – et parfois, à accompagner – les dissidences. Il ne s’agit pas de redessiner un autre plan-type, mais de rester dans le trouble : d’en faire un moteur de pensée critique et de projet spatial. ★
MBL Architectes
Ernst Neufert, la norme et l’exception par Ines Weizman • Chemsex domesticity par Thomas Gomes Daubernay • 40 m² d’espace supplémentaire par Tinatin Gurgenidze • Le placard, le labyrinthe et l’anté-placard par Benjamin Sauviac • Verticalité et esthétique de l’inaccessibilité par Enka Blanchard • Hôtels sans voyageur·ses par Soline Nivet • Hôtel Gondolin, habiter sa famille par Cécile Diguet • Plans dysfonctionnels par Mariabruna Fabrizi
- Rem Koolhaas, « Typical Plan » [1993], in S, M, L, XL (New York: The Monacelli Press, 1995)
- Judith Butler, Gender trouble, Feminism and the subversion of identity, (New-York : Routledge), 1990
- Donna Haraway, Staying with the Trouble (Duke University Press, Durham and London), 2016