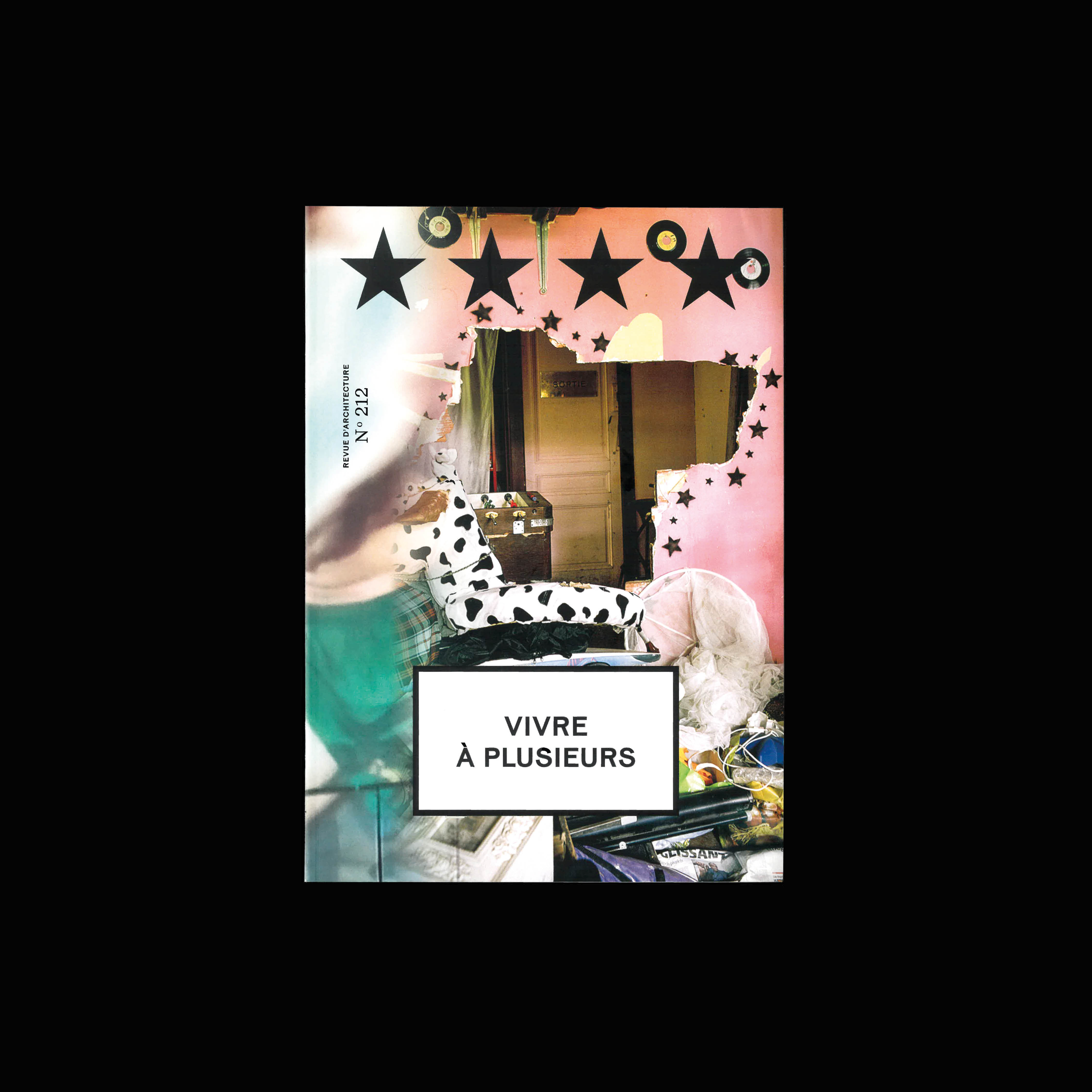
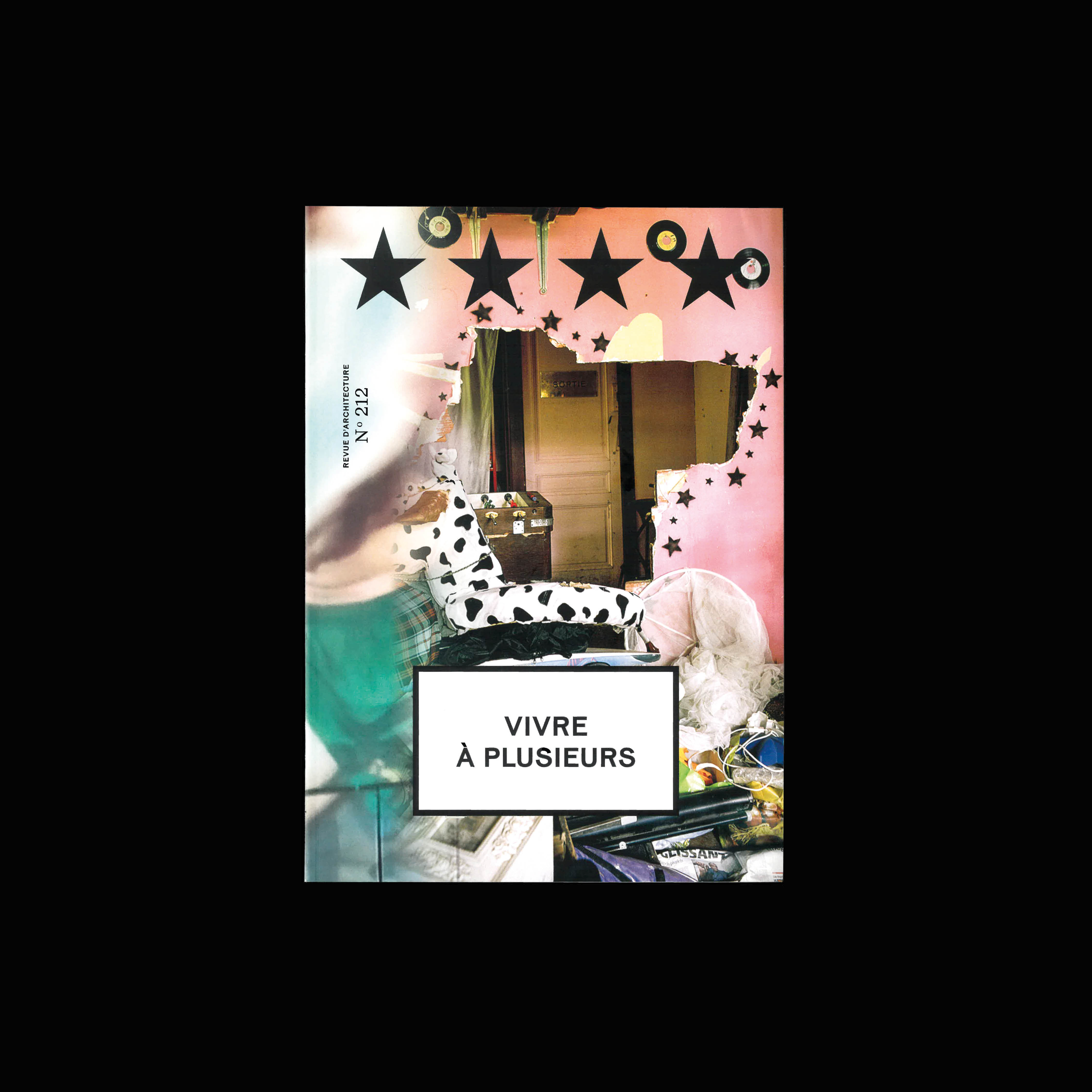
Vivre à plusieurs
« À quelle distance dois-je me tenir des autres pour construire avec eux une sociabilité sans aliénation », s’interroge Roland Barthes. Théorisé dans son ultime cours au Collège de France, son Comment vivre ensemble (1) traite de la tension fertile entre la solitude et la sociabilité. Il considère en premier lieu le rythme de vie de certains moines ou de personnages fictif·ves (2), rattaché·es à un lieu commun, mais vivant le plus souvent seul·es, en marge de la communauté. Le sujet ne se fond pas dans la collectivité. La communauté libre, ouverte, fluide ne saurait exister là où une certaine solitude n’est pas d’abord assurée pour que les autres ne constituent pas une « machine à uniformiser ». La gestion du temps et de l’espace ne doit pas s’opérer au détriment des rythmes de chacun·e. Afin que chacun·e se gouverne comme iel l’entend, son agenda n’est qu’entrecoupé par des moments de convivialité.
Le «vivre ensemble» est désormais galvaudé dans le champ de l’architecture. Maîtres d’ouvrage, élu·es et architectes l’emploient, sans nuance critique, comme des mots magiques. Iels simulent une bienveillance démagogique comme critère pour une existence meilleure. Ce « vivre ensemble » dissimule une prétention universaliste pour la masse informe et floue de celles et ceux qu’iels nomment « les gens ». Sous une prétendue intégration, l’universel exclut les différences. Plutôt que de vivre noyé·es dans un universalisme impossible, il s’agit déjà de cohabiter avec quelques autres. Les architectes et habitant·es ont la capacité à trouver ce juste équilibre entre le collectif et le personnel, tout en évitant l’impersonnel.
Faire partie d’une communauté implique un contrat social plus ou moins tacite. Un commun accord qui accepte l’improvisation et exige des inventions matérielles et opératoires. À un mot maltraité par l’usage courant, il convient donc de substituer, pour être à la hauteur et faire droit à la multitude, au vivre-ensemble un vivre-à-plusieurs.
Une communauté commence à partir de 3 individu·es. Dans son 3: une aspiration au dehors, Geoffroy de Lagasnerie esquisse un éloge pratique de l’amitié. « J’associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, l’ennui (…) Alors que l’amitié est l’espace d’aspiration à une vie au‐dehors, qui n’a pas de centre,une vie centrée sur la rencontre » (3). La précarité de l’amitié exige un soin constant, un entretien et des solidarités à fabriquer. Cette relation a été suspendue juridiquement durant la pandémie. Visiter sa famille : oui, ses ami·es : non. Les relations amicales ou communautaires n’ont pas d’existence légale, elles sont suspectes au regard de la loi. Pourtant, elles ne sont pas qu’un simple rapport affectif mais aussi un « espace d’expérimentation, de critique, de décentrement, un lieu où l’on s’invente en dehors des structures sociales instituées ». Elles sont un territoire vital, fragile, à cultiver avec rigueur et joie. L’architecture peut les accompagner, sans en faire une injonction.
Qu’elles soient identitaires, comme les retraitées des Babayagas de Montreuil; de circonstance, comme les «exclu·es» rassemblé·es dans les squat genevois ; ou temporaires comme ce lieu de retraite dans les Pyrénées, ces tentatives singulières expérimentent des dispositifs tant spatiaux que juridiques. Elles échouent parfois à inventer des lieux propres à leurs communautés mais ce qui compte est qu’elles sont les expertes, les conceptrices de leurs propres formes de vie. Sans naïveté, ce numéro considère les gloires et les échecs des valeurs et des idéaux communautaires.
Julia Albani, Ici, c’était un orchestre • Kloé Yannovitch, Habiter les Hauts Plateaux • Milena Charbit, La controverse des Babayagas • Line Fontana et David Fagart, Learning from squats • Hugo Soucaze, Vivre seul-en-communauté • Majma, Catherine Sabbah, Part-time parisiens. Le logement à temps partiel • Ahmed Belkhodja, Fictions, in vivo • Théo Gauthier, Qui a tordu la fenêtre ?
- Roland BARTHES, Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quelques espaces quotidiens. Notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1976-77
- Ce corpus réunit: A. GIDE, La Séquestrée de Poitiers ; D. DEFOE, Robinson Crusoé ; Th. MANN, La Montagne magique ; E.Zola, Pot-Bouille.
- Geoffroy de LAGASNERIE, 3: une aspiration au dehors, Flammarion, 2003.